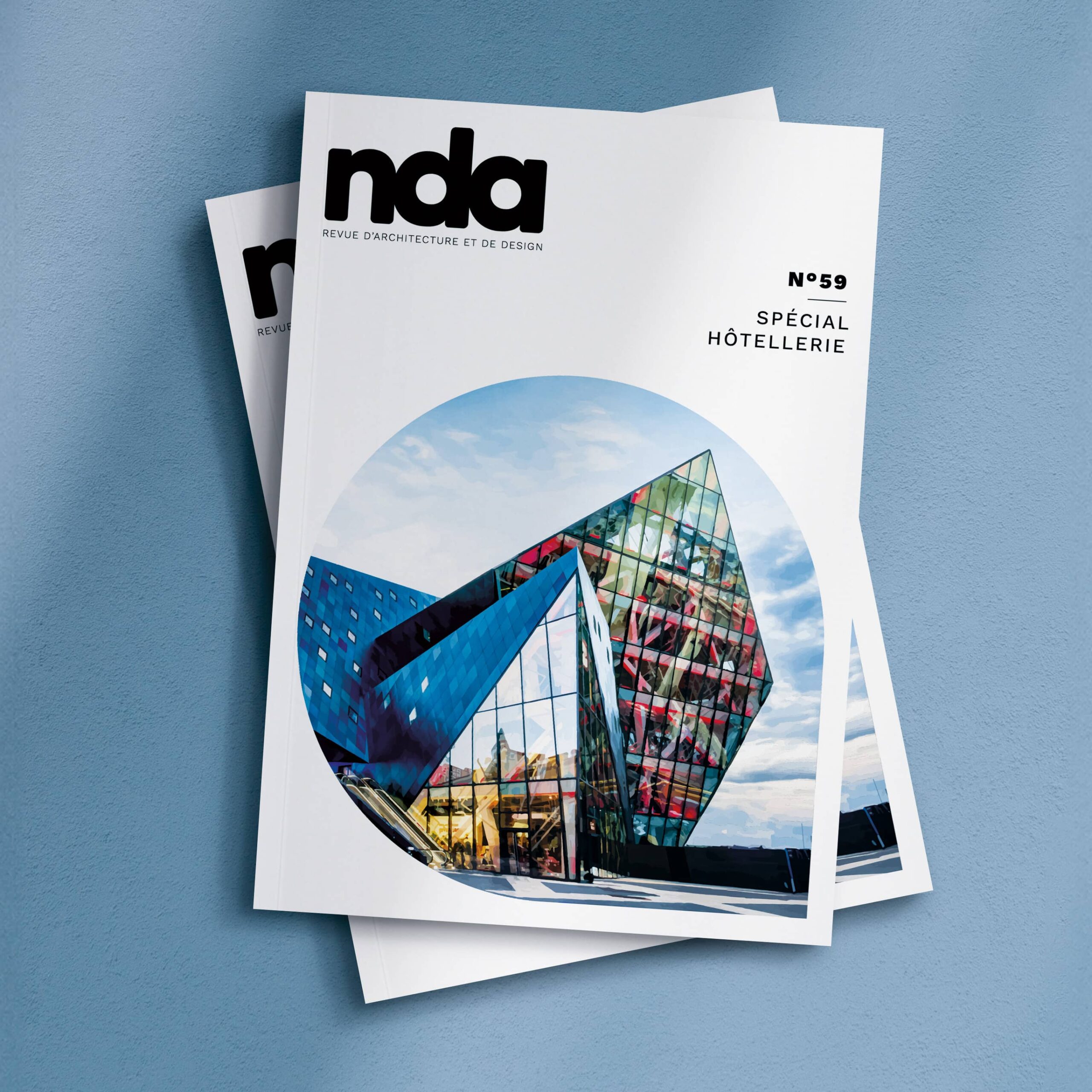MBL mène toujours l’enquête

Très fouineurs, les architectes Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore ont bien investigué. En 2023, à Paris, ils mettent leurs élucidations en pratique, avec la reconversion de l’îlot haussmannien de l’APHP.
On les a d’abord repérés à fureter un peu partout en France. À la revue Face b, avec Aurélien Gillier, où ils écrivent. À partir de 2015, on les suit à la Villa Noailles, où ils inventent des expositions aux sujets peu étudiés, comme les skateparks et les boites de nuit. On les retrouvera lors de la reconversion en cours de La Main Jaune à Paris. Les jeunes architectes Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore intriguent. Entre pop culture et radicalisme italien, un peu dandy un peu hardis, ils affirment leur volonté de participer à un débat sur l’architecture, qu’ils abordent « comme une recherche, une enquête ». Sébastien-Barat écrit : « En architecture on ne sait rien, notre savoir de réserve ne nous donne pas de longueurs d’avance… L’enquête dessine une trajectoire non linéaire, imprévisible et faite d’allers et retours. » Elle est la condition de la pensée éclectique qu’ils adoptent ; l’éclectisme serait « l’expression d’une enquête bien menée »1.
- Skatepark, Galleria Continua. © Maxime Verret
-
Lyon, maison dans les bois pour faire la fête.
© MaximeDelvaux
-
Galleria Continua et épicerie, dans le Marais.
© MBL
Ronds-points
C’est peut-être parce qu’ils ont vécu dans des cités pavillonnaires, du « vernaculaire industriel », que ces deux jeunes larrons, nés en 1983 à Toulouse, vont « se reconnaître » à l’école d’architecture de la Ville rose autour d’une vision architecturale et urbaine peu enseignée. Comme les ronds-points et lotissements. Pas dans un culte d’une banalité esthétisée si prisée, mais dans un rapport au réel, au quotidien, avec sincérité.
MBL architectes
12, rue Jean Pernin
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Tél. : 06 95 72 34 14.
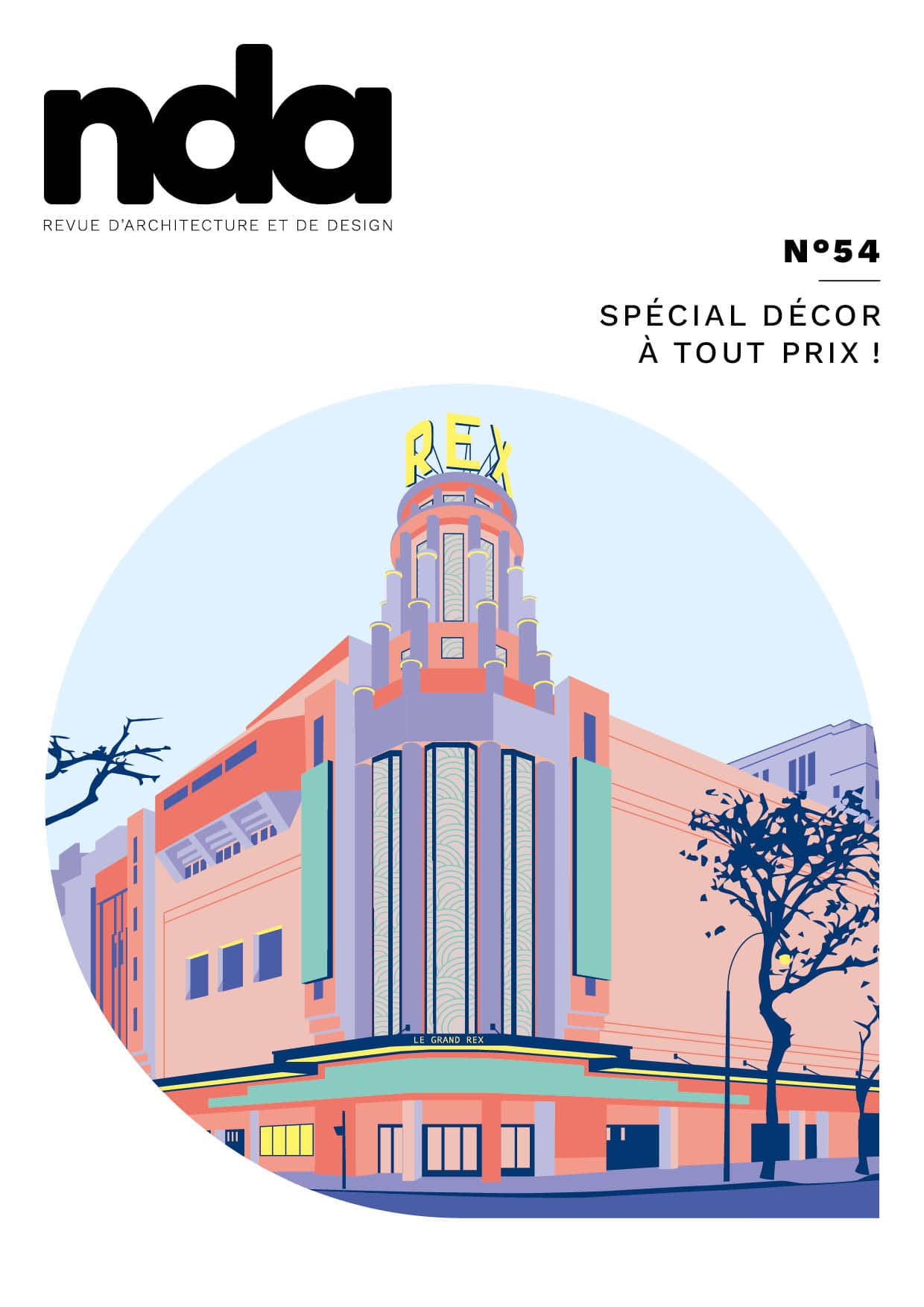
Décor à tout prix !
Commander
Numéro en cours
Nº63
Spécial Santé, Bien-être, Bien-vivre

Novembre — Décembre 2025 — Janvier 2026
Découvrir

Dernière ligne droite pour une distinction mondiale

CapitaSpring une expérience à part entière